Par Alain de Libera
Le Moyen Âge est l’âge d’or de la « dispute ». La disputatio est la clé de voûte de la transmission et de la production des savoirs dans l’institution reine du Moyen Âge occidental à partir de 1200 : l’Université. C’est à la fois une épreuve de qualification professionnelle, une technique pédagogique et un genre littéraire. Une dispute est une question disputée : la discussion argumentée d’un problème qui suit un protocole précis, ritualisé, mettant aux prises les maîtres et les étudiants, à divers moments de l’année académique, en ayant en vue la recherche de la vérité, plutôt que la victoire sur un adversaire.
A partir d’un panorama des sources, formes et genres de disputationes, à Paris et à Oxford, de leurs objets, de leurs méthodes, de leurs enjeux, Alain de Libera s’efforce de restituer au « Long Moyen Âge » (du 12e au 18e siècle) la place de cet exercice dans l’histoire de la rationalité. Alors qu’il devient aujourd’hui de plus en plus difficile de débattre de façon apaisée, à l’Université comme dans les différents médias, il nous paraît intéressant de ressaisir cet esprit de la dispute médiévale et comment il peut encore nous inspirer.
Comment ils se sont disputés
Logique et théologie à l’université de Paris, 1200-1793
L’âge d’or de la dispute est celui qui a vu naître, croître et se diffuser dans cette Europe, dont elle aura été une première esquisse, l’institution unique, inconnue des autres riverains de la Méditerranée, byzantins, arabes ou juifs, qu’on appelle l’« université ». C’est, on l’aura compris, l’âge dit « moyen », cet « Âge intermédiaire », media tempestas, ce Moyen Âge occidental que l’ancien secrétaire de Nicolas de Cues, Jean André de Bussi « louant son maître, disparu depuis peu, d’avoir lu tous les livres » situait en 1469, entre les anciens, les prisci, et les modernes, les moderni. Les médiévaux ne savaient pas qu’ils vivaient au Moyen Âge. Ils se disaient comme nous, « modernes » et, ce qui nous conduit à la « dispute », ils appelaient « logique des Modernes » (Logica Modernorum), la logique, autrement dit : les livres, le corpus, les exercices et les théories, qu’ils avaient eux-mêmes produits sur la base lointaine, partielle et fragmentaire des écrits logiques d’Aristote (m. 384-322 av. J.-C.) et de Boèce (†524), son premier grand traducteur latin. Cette « logique des Modernes » est la logique de l’École. La dispute en est le cœur vivant. Son histoire se confond largement avec celle d’une « Ecole » précise : l’universitas magistrorum et scholarium Parisiensis, autrement dit : l’Ancienne université de Paris, qui avec ses facultés et ses « collèges » aura vécu du15 janvier 1200 au 15 septembre 1793, de Philippe-Auguste à la Révolution française, ce qui correspond, pour l’historien de la philosophie, à ce que Jacques Le Goff a appelé, pour l’histoire, le « Long Moyen-Age ». Je me centre ici sur une seule faculté : la faculté de théologie, celle où ont lieu les grands « débats » philosophiques et théologiques, qui, au moment même où, voulant inaugurer un nouveau paradigme, il substitue des Meditationes de prima philosophia au format « disputationnel » illustré par les Disputationes metaphysicae de Suarez, verront Descartes dédier son œuvre aux Maîtres en théologie de l’université de Paris, pour la placer sous leur protection.
La disputatio est dans son essence, comme dans sa fonction, « scolastique ». Son lieu n’est ni la cour, ni le palais, ni le forum. Ce n’est ni un exercice rhétorique ni un débat organisé pour ou par un souverain. Ce n’est pas non plus un duel. C’est la discussion d’une question, suivant un protocole précis, ayant pour protagonistes non pas deux « adversaires », mais une pluralité d’intervenants dans un dispositif réglé. La structure de la dispute n’est pas duale. Elle est sociale ou collective. Ce n’est pas l’ombre portée du « dialogue » socratique ou de ses dérivés tardo-antiques. C’est avant tout intellectuellement, socialement, spirituellement, une prise de rôles continuée, où s’élabore le sujet de la science, se construit une épistémè. On peut être tenté de rapprocher de la disputation scolastique certaines controverses célèbres: comme a) celle de « Bagdad », entre le « grammairien » musulman as-Sirafi (m. 979) et le « logicien » nestorien Māttā († 940) sur la supériorité de leurs disciplines respectives, b) les controverses aragonaises avec des juifs, menées par les Frères Prêcheurs comme celle de Barcelone, organisée par le roi Jacques le Conquérant, en juillet 1263, quatre jours durant, entre le dominicain, juif converti, Pablo Cristiá et le rabbin de Gérone, Moïse ben Nahman (dont deux « procès verbaux » assez discordants nous sont parvenus, l’un en latin, de la main des Pères, l’autre en hébreu, de Nahmani lui-même) ou c) celle, fictionnalisée, sinon fictive, de Valladolid (1530, sous le règne de Charles-Quint et le pontificat de Jules III), portée à l’écran par Jean-Daniel Verhaege, d’après le dossier (roman, scénario et dialogues) de Jean-Claude Carrière, opposant le dominicain Bartolomé de Las Casas au philosophe Juan Ginés de Sepúlveda, dont l’essentiel – décider si les indigènes étaient des êtres humains et achevés – semble s’être joué on dirait aujourd’hui en distanciel, autrement dit par échange épistolaire, plutôt que dans le fascinant présentiel, porté par le jeu inspiré de Jean-Pierre Marielle et de Jean-Louis Trintignant. Aucune de ces discussions n’est pour autant une dispute au sens « scolastique ».
La disputatio, que l’on pourrait appeler « disputation », pour lever toute équivoque, est une méthode d’enseignement liée à une institution précise, l’université médiévale, née à une époque précise – au tournant du xiie au xiiie siècle – devenue par étapes et sous des formes précises la méthode de recherche scientifique caractéristique d’un âge précis de la science et de la sociabilité savante, dont l’université de Paris offre le modèle dominant qui s’est diffusé en Europe – en relation avec d’autres comme ceux d’Oxford ou de Bologne, ou ceux internes aux ordres religieux. La disputation est née de la leçon (« lectio »), par l’intermédiaire de la question (« quaestio »). Elle est devenue rapidement exercice autonome, ayant sa physionomie propre, ses lois et ses traditions. Elle constitue le second membre du trinôme : legere (« lire » un texte), disputare (« disputer »), praedicare (« prêcher », les trois obligations langagières qui structurent la vie universitaire parisienne, dans ses deux facultés : la Faculté des arts et la Faculté de théologie, et ses quatre « Nations » : Française (Français du Centre et du sud, les Italiens, les Ibériques), Normande, Picarde (Est et Nord de la France, ainsi que Belgique et Pays-Bas actuels) et Anglaise (les Britanniques, les Scandinaves, les Germaniques), au long d’un itinéraire de formation de vingt-cinq ans. Il faut en effet 10 ans d’études des « arts », en gros : la grammaire, la logique, la philosophie, suivis de 15 ans d’études de la théologie pour obtenir le titre à l’époque le plus prestigieux du monde savant en Europe : « maître en théologie de l’université de Paris ».
L’année scolaire, le « Grand ordinaire », chevauche deux années civiles. Elle commence le 14 septembre à l’Exaltation de la Sainte-Croix, qui commémore la consécration de l’église du Saint-Sépulcre en 335, pour se terminer le 13 septembre suivant. Elle ne connaît pas d’interruption véritable, en dehors d’une période qu’on dirait aujourd’hui « estivale », du 29 juin au 14 septembre, durant laquelle les maîtres ne donnent pas de cours (lectiones). On enseigne durant les jours dits « lisibles ». Les jours non ouvrables durant lesquels on ne « lit pas » (« non legitur »), parfois « ultra tertiam », parfois « post prandium » (les samedis de Carême), abondent : on en compte 79 par an. La disputation tient un rôle central dans l’organisation de la vie, la construction de l’ethos et la perception du temps académiques. Elle rythme l’année, la journée, la carrière.
L’université de Paris, université de maîtres qui s’autogouvernent, n’est pas une simple « multitudo » de maîtres, étudiants, officiers, notaires, appariteurs, stationnaires c’est une « communauté jurée » (réglée par des serments), soudée par l’affect et l’usage, où les étudiants doivent littéralement faire acte de présence, tout au long du cursus. Ces actes de présence sont, pour l’essentiel des actes de paroles – autrement dit, aussi, des actes de pensée : serments, sermons, lectures, disputations. Pour suivre toutes les étapes du cursus, qui mène de l’étude des arts à la maîtrise de théologie, l’étudiant doit franchir un certain nombre d’étapes ou d’épreuves qualifiantes. La vie de l’universitaire médiéval est une vie d’épreuves, dont le fil rouge est la disputatio.
Quelles sont ces étapes ?
Répondre, c’est distinguer les rôles. Il y a les maîtres et les étudiants. L’étudiant en théologie arrive, formé aux arts. Il commence, dans l’école d’un maitre, comme « bachelier bibliste », avec pour objectif le « baccalauréat sententiaire », qui lui permettra de candidater à la maitrise. Le maître s’occupe de ses étudiants. Étudiants et maîtres changent constamment de rôle. Le « bibliste » doit « lire » – expliquer – cursivement un texte, en l’occurrence la Bible, devant les autres étudiants et le maître. Mais il doit aussi, au cours de ses deux années de cursor, intervenir comme respondens, dans des actes solennels de l’université, – en l’occurrence des disputes, où se jouent, pour d’autres, les bacheliers sententiaires « formés », l’accession finale à la maîtrise. Il y est confronté à ses condisciples, à son maître, à d’autres maîtres.
Rivalité mimétique ? Éducation par le groupe ?
Disons plutôt : jeu de rôles. L’étudiant est d’abord un actant, occupant une place et exerçant une fonction dans une structure. C’est aussi évidemment un acteur. Mais cet acteur suit un parcours rigoureusement fléché dans un modèle actanciel – où, il y va, par l’échange de paroles, du travail de deux textes, la Bible, d’une part, les quatre livres des Sentences, d’autre part, le manuel d’enseignement de la théologie par quaestiones composé au xiie siècle par Pierre Lombard.
L’université de Paris est l’héritière des « petites écoles » de logique des années 1100, installées près du Petit-Pont (où se tiennent les Parvipontani), dans les rues de Garlande (aujourd’hui « Galande ») et du Fouarre (le vico de li strami, de Dante (Paradis, X, 136-138) rappelant le souvenir des « vérités importunes » syllogisées en ce quartier que l’on dit encore aujourd’hui « latin », sans trop savoir pourquoi, par Siger de Brabant), sans oublier la Montagne Sainte-Geneviève (où sont installés les Montani). Paris est la capitale de la « logique des Modernes », et des théo-logues, des théo-logiciens, que stigmatisera Luther en 1517 dans sa grande Disputatio contra theologiam scolasticam, en s’attaquant à la montruosité qu’est le « theologus logicus ». Ils y passent les Écritures au crible de la quaestio, pour articuler le contenu en objet de discussion pour et contre, et donc, ultimement en objets de savoirs, établis par la démonstration ou limités, pour de bonnes raisons, à la « ferme croyance », après le dépouillement et la confrontation des « autorités » et le déploiement des questions tirées de la « base des données » anciennes – bibliques, patristiques –, et contemporaines – magistrales – offertes à la discussion. Les Sententiae de Pierre Lombard, le Sic et Non d’Abélard jettent les bases, le socle épistémique de l’âge scolastique, qui sera celui du questionnement institutionnalisé. De fait, à partir de 1200, la vie de l’universitaire se déroule tout entière sous le signe de la dispute. De quoi s’agit-il ?
Il y a plusieurs sortes de disputes
Leur distinction tient « au nombre et à la qualité des acteurs qui interviennent ; à la qualité de celui qui préside et mène ; à la façon enfin dont sont choisies et proposées les questions ». On compte, à Paris, trois types de disputes : les questions disputées, les questions quodlibétales (de quolibet), la « Sorbonique » (Sorbonica).
La quaestio disputata
La quaestio disputata (ordinaria ou tentativa) est l’outil pédagogique de base : dirigée par les maîtres dans leurs propres « locaux » (in scolis propriis) elle mobilise les bacheliers, qui fournissent l’opposant (opponens) et le répondant (respondens), qui s’affrontent devant une assistance qui peut multiplier les « instances » (objections, contre-exemples, exceptions), et le maître qui peut, quand il le veut, interrompre le répondant pour corriger un argument ou préciser un point. Au premier jour « lisible » suivant la séance, ledit maître donne sa determinatio, en apportant une réponse au problème, après avoir passé en revue tous les éléments de la discussion, y compris la réponse de son bachelier. La tâche de l’enseignant est écrasante, l’exercice éreintant. N’oublions pas qu’il doit parallèlement « lire » et « prêcher ». Durant son premier enseignement parisien comme maître-régent (1256-1259), saint Thomas soutient les 253 « questions » de son De Veritate au rythme de 84, 84 et 85 par année scolaire, ce qui correspond à deux disputes régulières par semaine (plus 5 quodlibeta). Durant son second séjour (1268-1272), 101 « questions » De Malo , 21 De anima, 36 De virtutibus, 5 De Unione Verbi incarnati (plus 7 quodlibeta)
La question quodlibétique
La question quodlibétique ou « extraordinaire», porte divers autres noms « disputatio solemnis », pour son importance dans le rituel, « communis », parce qu’elle ne concerne pas la seule école du maître et naturellement « quodlibetalis » ou « quodlibetica », parce qu’elle peut porter sur n’importe quel sujet ( (« de quolibet ») : en Écriture sainte, théologie, philosophie, notamment, et être proposée par n’importe qui dans l’assistance – maîtres et bacheliers étrangers à l’école du maître qui dispute, personnages importants ou, dit-on, simples curieux. Chaque groupe de questions constitue un Quodlibet. La moyenne est de 15/20 questions. La difficulté de l’exercice fait que seuls les « grands » s’y aventurent. Certains s’en font une spécialité, et y donnent le meilleur de leur œuvre, recueillie par les étudiants. Les maîtres les plus prolifiques sont Gérard d’Abbeville qui laisse 20 Quodlibeta; Godefroid de Fontaines et Henri de Gand, 15 ; Jean de Naples, 13 ; Thomas d’Aquin, 12 ; Hervé de Nedelec, 10 ; Pierre de Jean Olieu (Olivi) et Gervais du Mont-Saint-Éloi, 8 ; Raymond Rigauld et Guéric de Saint-Quentin, 9 ; Gilles de Rome et Guillaume d’Ockham, 7. Contrairement aux Questions Disputées, au rythme hebdomadaire, il n’y au xiiie siècle que deux sessions de disputes quodlibétiques à Paris : la session de Noël durant la seconde semaine de l’Avent ; la session de Carême située entre le troisième dimanche de Carême et le dimanche des Rameaux. Au xive, on ne compte plus que la session d’Avent. Au premier premier jour lisible après la séance de discussion, le maître reprend ordonne, reclasse, remanie, répartit, ventile pour son auditoire habituel tout ce qui a été dit par les divers protagonistes, en s’appuyant sur ses notes ou les « reportations » prises par ses bacheliers et étudiants.
La Sorbonique
Reste la « Sorbonique », disputatio sorbonica – la Trade mark de l’université de Paris. Elle concerne les étudiants, durant le « Petit ordinaire », la période d’été où les maîtres suspendent leurs enseignements. Tous les bacheliers sont concernés – le cursor doit participer à au moins une séance, pour accéder aux Sententiae, de même le sententiaire formé, pour accéder à la licence. Le jeu a ses règles : le prieur de Sorbonne, qui n’est pas maître, préside ; interviennent un opposant principal, qui a droit à 8 arguments, des opposants secondaires, à 3, un répondant, qui a droit à trois « conclusiones », et deux arguments pour chaque conclusion ; mais la porte est de la discussion est ouverte à d’autres protagonistes – si le cœur leur en dit : le maître des étudiants en lice, le prieur, d’autres maîtres, et finalement tous les bachelierq et étudiants selon leur ancienneté.
Ces disputes – ordinaires, quodlibétiques, sorboniques – attestent ce qu’on pourrait appeler la polyphonie du sujet de la science médiévale. Le rituel académique intervient à tous les niveaux, instillant la disputation – le collectif – à tous les stades de la prise générale de rôle : à l’inceptio du cursor (quand il inaugure les deux cursus consacrés chacun à un livre de la Bible), au principium du sententiarius, quand il inaugure sa lecture des Sentences, par un « discours », la collatio, faisant l’éloge d’un des quatre livres composant l’œuvre du Lombard, portant respectivement sur Dieu, la Création, la Rédemption, les sacrements, exercice dont sortira la quaestio collativa, rien n’arrêtant le mouvement de la mise en questions généralisée. La fréquence des principia – un par jour lisible au début de chaque trimestre, entraine une sorte de dialogue continu, qui voit les bacheliers se répondre d’un principium l’autre, d’une question collative l’autre, de trimestre en trimestre, voire d’année en année. L’université produit son propre corpus. Elle est son propre corpus. Elle est sa propre mémoire.
La toute-puissance de la disputation, son empire, son emprise culminent dans les actes de maîtrise, la prise de rôle du magister. Le candidat à la maîtrise, admis à la licence d’enseignement à l’âge minimum de 35 ans, le futur maître, le « magister aulandus », a devant lui une dernière série d’épreuves, deux disputes solennelles qu’il doit soutenir, en présence de toute la faculté de théologie : les « vespéries » et l’ « aulique », où seront discutées quatre questions qu’il aura lui-même soumises à la communauté universitaire. C’est l’occasion d’un remarquable jeu de rôles. Les vespéries ont, comme leur nom l’indique, lieu l’après-midi, autour des deux premières questions proposées, en deux actes distincts : l’« exspectativa magistrorum » et les « vespéries » proprement dites, conclues par le maître de thèse, le magister aulator.
L’Expectativa magistrorum, « l’attente des maîtres », première passe entre étudiants, est un lever de rideau, portant sur la première question, où un bachelier sententiaire fait office de responsalis. Les Vesperiae proprement dites, qui portent sur la deuxième question, placent le Vesperiandus, ‘V’, le futur maître, sur la sellette, suivant un déroulement précis. ‘V’ affronte deux des maîtres les plus anciens de la faculté. L’ainé, appelons-le ‘M1’ formule le problème soulevé par la question. ‘V’ prend position, donne ses arguments. ‘M1’ conteste lesdits arguments, en leur opposant trois ou quatre rationes. ‘V’ répond, en réfutant au moins deux d’entre elles. Le processus est repris une 2ème et une 3ème fois. Vient ensuite le tour du second maître : ‘M2’. Celui-ci présente ses propres objections contre les positions de ‘V’, qui réplique. Le processus est repris une fois. La séance se termine : un nouveau maître est né. L’Aulator fait l’éloge de l’Écriture, puis celui du Magister novus.
Vient le grand spectacle, donné dans la grand salle de l’évêché – Aula maxima. Les deux disputes de fin d’études. Tout le monde académique est là réuni, siégeant pour ainsi dire en majesté, face à la communauté rassemblée : le nouveau maître, à ce moment Magister aulandus, est assis au centre avec à sa droite le chancelier et les maîtres plus anciens selon leur ordre de préséance, à sa gauche, le Magister aulator, et les autres maîtres. Le chancelier reçoit le serment de l’Aulandus ; son « parrain », l’Aulator lui remet la barrette ; le nouveau maître prononce un Éloge de la sainte écriture. On passe alors aux choses sérieuses : les disputes, l’Aulique, portant sur la 3ème question, et la Quaestio Magistrorum, traitant de la 4ème.
L’Aulique met en vedette un bachelier sententiaire, désigné par l’Aulandus. Son cahier des charges est précis : la réponse à la question doit être positive, présentée en trois conclusions démontrées et trois corollaires, elle est alors attaquée par l’aulandus en trois objections auxquelles le responsalis répond par deux séries de distinctions, puis par l’aulator, selon le même protocole : trois objections, deux réponses, par le chancelier, avec deux objections, ouvrant droit à une réponse.
La Quaestio Magistrorum est le tableau final – les maîtres, « attendus » dans l’Expectiva sont là pour le baisser de rideau. Quatre maîtres en l’occurrence, qui s’affrontent par paires : a) un des plus vieux contre un des plus jeunes ; b) un moins vieux contre un moins jeune. (a) : le maître aîné pose le problème de la 4e question, avec arguments pour et contre ; le plus jeune répond « magistralement », en prenant position avec ses raisons, l’ainé les conteste avec deux ou trois arguments, le jeune répond. On recommence une 2e et une 3e fois. (b) : les deux autres maîtres entrent en scène, pour deux passes d’objections (au lieu de trois) obligatoirement nouvelles –, ‘b’ doit être différent de ‘a’ (on ne peut reprendre les mêmes arguments). Le nouveau maître conclut en indiquant sa position formulée en une ou deux conclusions sans donner ses arguments.
Il n’en a pas fini pour autant. Si l’on regarde bien, c’est la faculté tout entière qui a participé à la disputation, intervenant comme sujet de plein exercice, comme sujet à part entière. Le récipiendaire n’a pris position ni sur Q1 (où il ne « jouait pas ») ni sur Q3 (où il servait de faire valoir à son bachelier). Il n’est intervenu en « maître » véritable que sur Q2, et brièvement, pour terminer la journée, sur Q4. Une dernière « séance » a pour but de combler ces lacunes, en lui redonnant la parole pour le « dernier mot » : c’est la Resumpta, la « Resompte », autrement dit : la « reprise ». Elle a lieu lors de la première leçon du nouveau maître, au premier jour lisible suivant sa promotion, dans son école. C’est le morceau de bravoure, la Determinatio valde prolixa que chacun attend. Il y est surtout question de Q3 – le maître pouvant à ce moment « faire la leçon » au bachelier qui a porté la discussion durant l’Aulique. Elle occupe toute la matinée, et, on peut l’imaginer, elle fait salle comble, les autres écoles faisant relâche, en suspendant leçons et disputes.
On le voit, la dispute scolastique est un acte universitaire dans le plein sens du terme, c’est par excellence l’acte de l’université. Elle a ses règles strictes, et ses normes. Mais elle est avant tout l’affirmation et la réalisation d’une norme qui donne son sens à toute la vie académique : la norme du vrai. Chaque rôle d’une dispute ordinaire réclame des qualités précises : celui d’opponens exige, dit Thomas d’Aquin, la vivacité d’esprit, le discernement, l’acumen intellectus nécessaire pour trouver les « voies raisonnables permettant de bien montrer ce dont il s’agit », celui de respondens exige en revanche de la sagesse, « pour bien juger de ce qu’on entend ». Mais le but de tous est la vérité. Thomas le dit clairement dans son Commentaire sur Job : bien disputer c’est surmonter les trois obstacles dressés contre le but de la dispute véritable – la découverte de la vérité, inséparable de la justice d’une cause. Le premier : ne pas vouloir entendre ce que dit l’adversaire ; le second : répondre à ce que l’on entend par des cris ou du mépris ; le troisième : rechercher non pas la vérité, mais la victoire ou la gloire :
“… hoc est enim primum impedimentum veritatis inveniendae per disputationem, cum aliquis ea quae ab adversario dicuntur audire non vult. Secundum impedimentum est cum ad audita clamose et contumeliose respondet… Tertium impedimentum est cum aliquis in disputatione non intendit ad veritatem sed ad victoriam et gloriam, ut accidit in disputationibus litigiosis et sophisticis.”
(Expositio super Iob ad litteram 6.28-29).
La théologie médiévale n’est pas un sport de combat. La disputatio scolastique relève du « genre doctrinal » défini par Aristote (syllogisant à partir des principes propres à une science), non du genre « dialectique » (syllogisant à partir de prémisses simplement probables). Naturellement, dans son déroulé, elle fait place à ce qui « apparaît au répondant », puisqu’il s’agit non pas seulement de former des étudiants à la discussion – ce qui a été amplement fait à la faculté des arts, grâce aux disputationes de sophismatibus – mais d’enseigner comment travailler un concept, tester une distinction, critiquer un argument pour arriver au vrai en des matières touchant aux articles de foi. Mais, il s’agit aussi d’intervenir dans une discussion scientifique suivie par un auditoire, puis un lectorat potentiellement européen, de par la peregrinatio academica, la « mobilité étudiante », ce phénomène fondamental décrit par Jacques Verger. Cela implique de prendre position sur des questions qui engagent à un moment donné, dans un contexte donné, la communauté des maîtres et, au-delà, l’existence même de la théologie comme science et la fonction de l’université dans la société chrétienne. La dispute va de pair avec la lectio : on ne peut les séparer. Toutes deux font vivre une « tradition » philosophique fondée sur la « volonté de savoir », et, pour parler comme Foucault, qui le déplore, sur la victoire de l’apophantique sur la sophistique, de l’héritage d’Aristote et de Platon sur celui du sophiste.
Le paradoxe n’est qu’apparent, qui voit l’âge du triomphe de la logique dans l’enseignement sceller au moyen de disputationes, celui de la défaite « historique » du sophiste. C’est que l’on sous-estime l’importance du type de sociabilité savante mis en œuvre dans l’université médiévale, axé dans tous les domaines sur la quaestio, qu’il s’agisse de lire, de disputer et même de prêcher. L’histoire de la disputatio relève d’une histoire de la vérité, axée sur les questionnaires plutôt que sur les réponses apportées à des problèmes supposés « éternels ». A ce titre elle concerne aussi bien la culture du commentaire que celle de l’argument, distinguées géoculturellement par certains philosophes analytiques. C’est à Paris, via la Nation anglaise qu’ont eu lieu les premiers affrontements entre la tradition logique parisienne et celle d’Oxford. Le chapitre n’est pas clos.
Alain de Libera
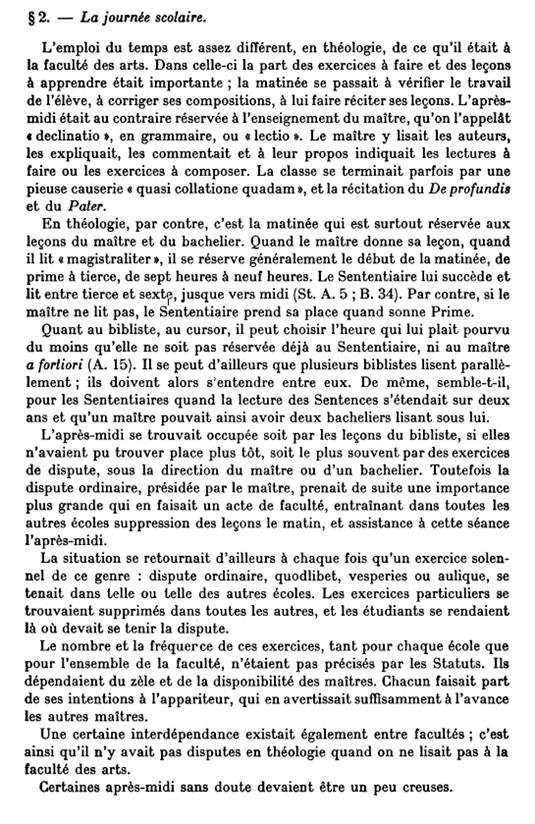
Bibliographie
B. Bazán, « La Quaestio disputata », in Les Genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve, 25-27 mai 1981, Louvain-la-Neuve, 1982, p. 31-49.
B. Bazàn, J.F. Wippel, G. Fransen, D. Jacquart, Les Questions disputées et les questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine, Turnhout, Brepols (Typologie des sources du Moyen Âge Occidental, Fasc. 44-45), 1985.
P. Glorieux, La littérature quodlibétique de 1260 à 1320, volume I, Kain 1925 ; volume II, Paris, 1935.
P. Glorieux, « L’Enseignement au Moyen Age: Techniques et méthodes en usage à la Faculté de théologie de Paris, au xiiie siècle », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, Vol. 35 (1968), p. 65-67, 69-103, 105-186.
A. de Libera, La Philosophie médiévale, 3e édition mise à jour avec une nouvelle bibliographie, Paris, Puf (Quadrige manuels), 2019.
Chr. Schabel (éd.), Theological Quodlibeta in the Middle Ages. Vol. 1: The Thirteenth Century ; Vol. 2: The Fourteenth Century, Leiden, Brill (Brill’s companions to the Christian tradition : a series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500-1700, vol. 7), 2006 et 2007.
J. Verger, « Peregrinatio academica », in G.P. Brizzi- J. Verger (éds), Le università dell’Europa: gli uomini e i luoghi. Secoli XII-XVII, Milan, 1993, p. 107-135.

